Colonel à la retraite et directeur de Cameroon Consulting and Prospective, l’ancien chef de la communication des Forces armées camerounaises analyse le retrait du Niger de la Force multinationale mixte et ses conséquences sur la lutte contre Boko Haram.
Qu’est-ce qui justifie selon vous, le retrait du Niger de la FMM ?
Le retrait du Niger de la Force multinationale mixte (FMM) intervient dans un contexte régional complexe marqué par des événements politiques et sécuritaires majeurs. L’évènement essentiel autour duquel gravitent bon nombre de questions stratégiques actuelles demeure le coup d’État survenu au Niger en juillet 2023, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum et mis en place une junte militaire dirigée par le général Abdourahamane Tiani. Ce coup de force contagieux intervient dans le paysage politique ouest africain, engendrant des frictions notables avec la communauté internationale et la CEDEAO, organisation sous-régionale de l’Union Africaine. Les relations ne se sont pas rétablies dans le temps, et la création d’une nouvelle organisation intergouvernementale fondée sous la forme d’un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous des juntes militaires, ont un dénominateur commun marqué par une distanciation nette avec les anciennes puissances coloniales et leurs affidés. La création de cette nouvelle organisation a créé entre ses membres de manière consensuelle, un réajustement des priorités du pays en matière de politique étrangère, avec à la clé, des critiques acerbes de l’influence et les interventions militaires extérieures, en particulier celle des forces françaises dans le cadre de l’opération Barkhane et du G5 Sahel. Le retrait de la FMM peut être vu comme une continuation de cette politique visant à réaffirmer la souveraineté nationale et à marquer une rupture avec les partenaires militaires traditionnels, en particulier la France, surtout que les pays de la CLBT -en dehors du Tchad qui garde une position mitigée- sont des pays dits constitutionnellement stables, avec des gouvernements civils. Il est question pour le Niger de définir ses priorités sécuritaires, déjà, en redéfinissant sa propre stratégie de sécurité, sans l’influence directe de forces extérieures, mais en se concentrant sur la nouvelle sécurité collective qui réunit mieux des idéologies partagées.
Quelles peuvent être les conséquences de ce retrait sur la lutte contre Boko Haram ?
Certains partenaires occidentaux ont exprimé leur inquiétude sur la stabilité de la sécurité dans la sous-région concernant la lutte antiterroriste. Le Niger était tout de même un pilier du dispositif et permettait d’agir en premier rideau contre les flux terroristes provenant du Nord, tout en concentrant les forces sur le Lac Tchad avec les autres pays de la ligne de front (Stratégie de la concentration des forces). Il va sans dire que ce retrait impactera sur la maximisation de la puissance, ainsi que sur l’économie des forces. La coopération avec les autres membres sera affectée, avec une translation du Centre de gravité du Niger vers le Nord. Les capacités de renseignement vont diminuer. En effet, le manque d’informations fiables provenant de la part des autorités nigériennes pourrait entraver l’efficacité des opérations contre les jihadistes dans le Sahel et le Bassin du lac Tchad.
Comment le Cameroun doit-il s’adapter à ce retrait ?
Le Cameroun reste un acteur respecté au sein de la Communauté régionale. Il est bien resté seul au front au tout début de la guerre contre Boko Haram. Le retrait d’un partenaire qui était important dans la stratégie globale de lutte affectera le renseignement, l’absorption de masses belligérantes fixées par le contact par ailleurs, toutes choses qui conditionneront une nouvelle approche stratégique des pays de la nouvelle ligne de front qui devront manifester plus de synergie, plus d’engagement et des moyens logistiques plus conséquents. Le mot-clé de cette guerre est la collaboration, avec un dosage sans retenue de la techno guerre et de la guerre rustique. Pour diminuer les élongations opérationnelles, il faudra passer à une doctrine de « dronisation du théâtre ». Ce que nous redoutons le plus aujourd’hui, c’est un retour de velléités westphaliennes de nos États qui peuvent subitement redevenir frileux au communautarisme sécuritaire. Cette posture serait une erreur rédhibitoire.
Après la récente attaque de Wouglo, peut-on dire que Boko Haram a repris du poil de la bête dans le Bassin du Lac Tchad ?
La dernière attaque de Wouglo fait suite à deux autres attaques d’envergure qui se sont déroulées à Barkaram (Tchad) en octobre 2024 et au Sud-Est du Nigéria le 26 mars 2025, sur une base militaire et un poste de sécurité dans l’État de Borno, tuant au moins 16 personnes. Au Tchad, l’attaque avait été particulièrement violente. Les djihadistes ont attaqué l’île de Barkaram, tuant au moins 40 soldats tchadiens et blessant une vingtaine d’autres. Les assaillants ont occupé le camp militaire jusqu’à l’aube, récupérant des armes et incendiant des véhicules équipés d’armes lourdes avant de se retirer. Lors de la contre-offensive, le Tchad avait regretté qu’elle ait opéré seule et a remis en question la sincérité de ses alliés. L’intensification de la stratégie de Boko Haram, qui semble se renforcer en termes de capacités et d’extension géographique est avérée. Elle a aussi mis en évidence l’augmentation de l’usage de tactiques de guérilla par le groupe, notamment des embuscades, des attaques contre des cibles militaires et des villages isolés. Ce genre d’attaque indique une capacité accrue pour l’ISWAP à mener des opérations coordonnées, ce qui est un signe de résilience et d’envergure croissante. Devant une telle gradation, les pays contributeurs de la ligne de front trouveront certainement des réponses pertinentes. Tout le monde devrait jouer sa partition : la population, en renforçant le renseignement prévisionnel, et les armées, en augmentant leurs capacités. Il faut dire enfin que le théâtre est dynamique et est le sanctuaire de la créativité stratégique. Rien n’est figé, et cette dynamique priorise des ordres de conduite.
Le danger d’éclatement de la FMM plane toujours au gré des atermoiements de ses membres, pour une sécurité collective qui aura été jusqu’alors exemplaire. Il est à notre avis temps de se reconditionner, si l’on veut contrer efficacement l’ISWAP qui a augmenté notoirement ses capacités. Le renseignement et l’étroite collaboration restent les facteurs essentiels de succès.
Source : L’Œil du Sahel






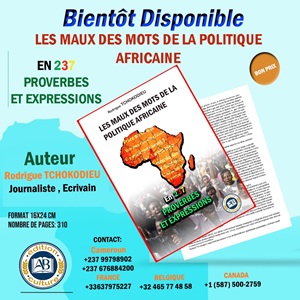






Comments