Par Charles Menye, pour le Comité Citoyen de vigilance Financière CEMACIien engagé
En Afrique centrale, il y a des chiffres qui rassurent… et d’autres qui dérangent.
Du côté des grandes institutions financières, les indicateurs sont au vert :
En 2024, la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a réalisé un bénéfice net record de 336 milliards de FCFA.
Ecobank Cameroun, l’une des principales banques commerciales de la sous-région, a enregistré 21 milliards de FCFA de bénéfice, en hausse de 47 % par rapport à 2023.
Sur le papier, ces résultats sont impressionnants. Ils sont souvent présentés comme des preuves de bonne gestion, de rigueur et de performance.
Mais dans la rue, dans les marchés, dans les zones rurales et dans les quartiers populaires, une question se répète :
Comment peut-on avoir autant de profits en haut… alors qu’en bas, rien ne bouge ?
C’est ce paradoxe est ce que nous allons explorer. Non pas pour dénoncer, mais pour comprendre. Et surtout pour interroger les choix que nous faisons collectivement avec l’argent public ou institutionnel.
Un secteur financier rentable dans une économie en souffrance
Commençons par un constat simple : les institutions financières de la CEMAC gagnent de l’argent dans une économie qui, elle, ne décolle pas.
– Le chômage reste élevé.
– Les petites entreprises n’arrivent pas à obtenir de crédits.
– Les produits de première nécessité sont chers.
– Les États manquent de marges de manœuvre budgétaire.
– Et la croissance, lorsqu’elle existe, reste trop faible pour absorber les besoins de base des populations.
Alors, comment expliquer cette situation ?
Comment les banques gagnent-elles autant… quand personne n’arrive à emprunter ?
Une finance qui se finance elle-même
C’est ici que le système montre ses limites.
La rentabilité actuelle du secteur bancaire et financier repose moins sur l’activité économique que sur le fonctionnement interne du système.
Côté BEAC :
- Elle place ses réserves de change sur les marchés internationaux (dollar, euro, etc.), ce qui lui rapporte des intérêts importants.
- Elle prête aux banques commerciales, avec un taux directeur à 5 % en 2024.
- Elle conserve les dépôts obligatoires des banques, qui sont peu ou pas rémunérés.
- Elle réalise des opérations de change, qui peuvent générer des gains.
Côté banques commerciales comme Ecobank :
- Elles empruntent à la BEAC à des conditions avantageuses.
- Elles prêtent à leur tour à des taux bien plus élevés (souvent entre 10 % et 12 %) parfois même usuraires mais uniquement à des clients considérés comme sûrs : grandes entreprises, institutions, fonctionnaires.
- Elles investissent leurs excédents en placements à faible risque (bons du Trésor, dépôts BEAC).
- Elles vivent aussi des commissions et frais bancaires, parfois très lourds pour les petits clients.
Résultat : même si le volume de crédit baisse, comme c’est le cas pour Ecobank Cameroun (-15 % en 2024), les profits augmentent.
La machine à argent fonctionne… même si elle ne sert plus l’économie productive.
C’est là tout le paradoxe : les institutions financières prospèrent en tournant sur elles-mêmes.
Des bénéfices impressionnants… mais une redistribution qui interroge
Que fait-on de ces gains ?
- La BEAC a choisi de verser des primes exceptionnelles à ses dirigeants (jusqu’à 250 %), de majorer les indemnités de ses administrateurs, et de doubler les gratifications de son personnel.
- Ecobank Cameroun a opté pour une redistribution de 90 % de son bénéfice net aux actionnaires, soit près de 19 milliards de FCFA.
On peut comprendre qu’une institution veuille récompenser ses équipes ou ses investisseurs. C’est légitime.
Mais dans une région où les besoins sociaux sont immenses, où l’accès au crédit reste un privilège, et où l’investissement public est contraint, on est en droit de se demander :
Ces bénéfices n’auraient-ils pas pu être mieux utilisés ?
Et si c’était un signe de manque de confiance dans la région ?
Un autre point mérite réflexion.
Quand une banque, publique ou privée, choisit de redistribuer massivement ses bénéfices au lieu de les réinvestir, cela peut être un choix stratégique conservateur :
“Mieux vaut sécuriser ce qu’on a gagné aujourd’hui… que prendre des risques pour demain.”
Mais ce choix peut aussi être le reflet d’un doute plus profond :
- Manque-t-on de projets bancables en zone CEMAC ?
- Les institutions ont-elles perdu confiance dans la capacité de la région à croître ?
- Ou est-ce tout simplement plus rentable, aujourd’hui, de ne rien faire que d’investir ?
C’est un débat qu’il est temps d’ouvrir.
Parce que l’argent dort en haut pendant que les idées meurent en bas.
Et maintenant, on fait quoi ?
Ces bénéfices doivent être vus comme une chance historique.
Ils pourraient être utilisés pour bâtir un futur plus inclusif et plus solide, au lieu d’entretenir un entre-soi institutionnel.
Voici trois leviers concrets et réalistes :
- Créer un fonds régional de garantie pour les PME
Les banques refusent souvent de financer les petites entreprises car elles n’ont pas de garanties solides. Un fonds public ou semi-public pourrait couvrir une partie des risques, et ainsi faciliter des milliers de projets viables.
- Soutenir les crédits à taux réduit pour les jeunes, les femmes et les TPE
Avec une part des bénéfices, on pourrait lancer des lignes de crédit bonifiées, accessibles, simples, adaptées aux réalités du terrain.
- Investir dans les filières locales de production
Financer la transformation agricole, les industries de proximité, les énergies renouvelables… pour créer des emplois, réduire les importations, stabiliser les prix.
Conclusion : les chiffres ne suffisent pas, il faut du sens
Il est légitime de vouloir une finance rentable. Mais il est plus urgent encore d’exiger une finance utile, connectée à la réalité, et au service de la transformation économique.
Un secteur bancaire fort ne vaut rien s’il ne sert qu’à enrichir les banques.
Il doit devenir un levier pour que toute la région avance, pas juste quelques comptes en haut de la pyramide.
La stabilité monétaire est importante. Mais elle ne suffit pas à elle seule à améliorer la vie des gens.
Les chiffres sont bons.
Maintenant, il faut qu’ils servent à quelque chose.







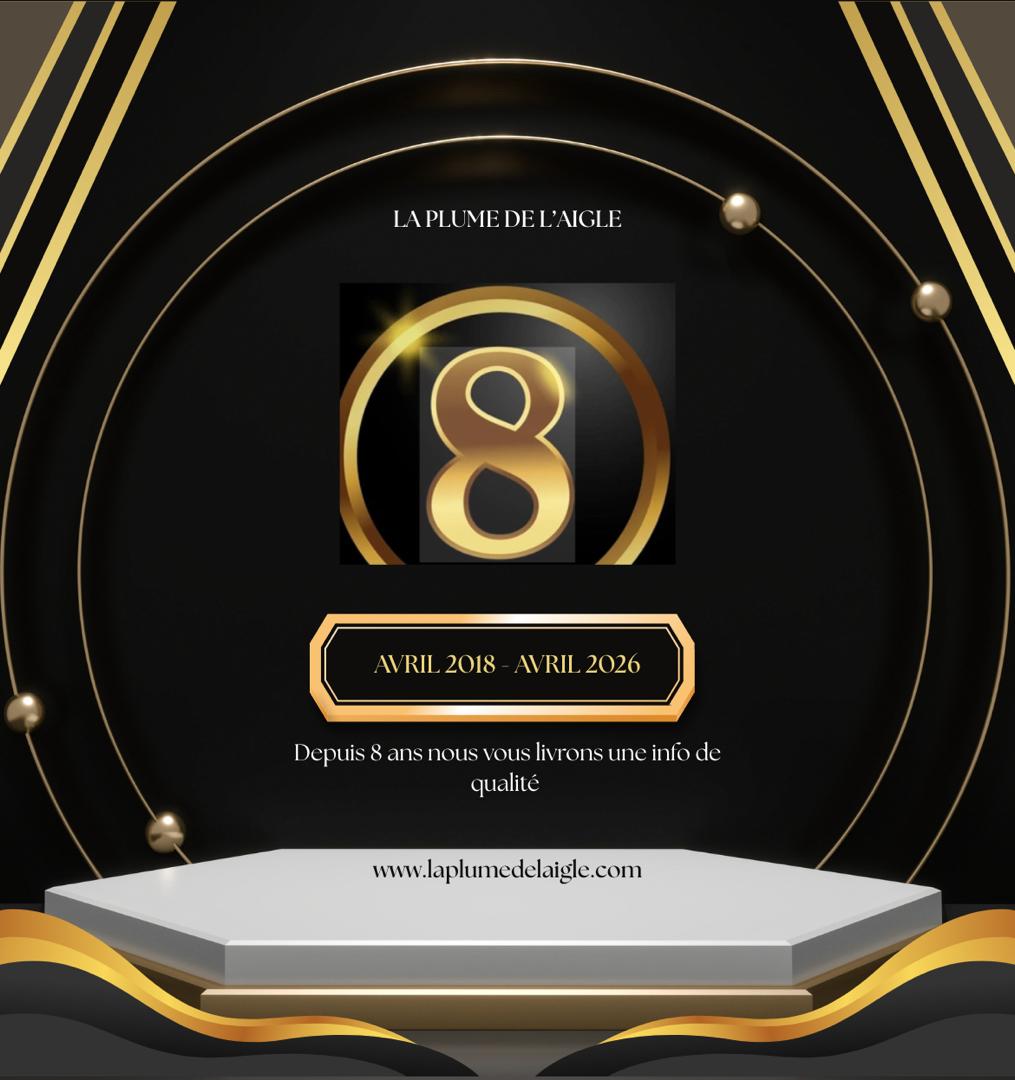






Très belle analyse!
Avec pour complément qu’en l’état des choses, les principaux bénéficiaires de cette embelie du secteur bancaire sont les multinationales étrangères car nos économies étant structurellement importatrices, l’essentiel des flux bancaires sont hors zone CEMAC.
Voilà pourquoi la proposition d’un fond pour les PME, TPE et Microprojets est très pertinent : la BEAC étant une institution des États-Unis membres, ces derniers peuvent statutairement décidé que ses bénéficies alimentent un fond sous-régionale dédié…
En tout cas, très bon article et mes encouragements.