Pour une régulation bancaire Visible, Audible et Responsable (VAR).
Par Charles Menye – Président du Comité Citoyen de Vigilance Financière – CEMAC (CVFC)
La régulation comme pilier de la stabilité.
Dans toute union monétaire, la stabilité repose sur un triptyque fondamental :
- une monnaie crédible,
- des banques solides,
- et une régulation digne de confiance.
En zone CEMAC, cet équilibre s’appuie sur un cadre institutionnel bien défini :
- Les États membres ont adopté des règlements communautaires harmonisés, et renforcé les pouvoirs des institutions régionales ;
- La BEAC, en tant que banque centrale, veille à la stabilité monétaire, en contrôlant l’inflation et en assurant la convertibilité du franc CFA ;
- La COSUMAF, en charge des marchés financiers, travaille à plus de transparence via des publications régulières et une bourse modernisée ;
- Et la COBAC, bras opérationnel de la BEAC, a la lourde responsabilité de garantir la solidité du système bancaire régional.
Mais dans un monde en mutation, où les crises sont plus fréquentes et les exigences de transparence plus fortes, une question se pose avec insistance : comment faire évoluer la régulation pour qu’elle reste un socle de confiance et un repère en période d’incertitude ?
C’est cette interrogation qui nous conduit à proposer une nouvelle posture pour la régulation bancaire : Visible, Audible et Responsable, ou V.A.R.
La COBAC, gardienne trop discrète d’un système en quête de clarté
Depuis 1990, la COBAC assume le rôle de superviseur bancaire dans la région. Sa mission est claire :
- accorder les agréments aux établissements financiers,
- veiller à leur conformité,
- sanctionner les manquements,
- et garantir la protection des usagers.
Mais au-delà de ces missions techniques, la COBAC est dépositaire d’un bien immatériel fondamental : la confiance.
Dans un secteur où tout repose sur le crédit, cette confiance ne se proclame pas — elle se mérite.
Et pour cela, il faut de la transparence, de la constance… et surtout une communication claire.
Un régulateur 3I : Invisible, Inaudible, Irresponsable ?
Théoriquement, la COBAC occupe une place centrale dans l’architecture de la stabilité financière de la CEMAC.
Mais si l’on observe les faits, une autre réalité émerge. Face aux attentes croissantes, elle donne parfois l’image d’un régulateur 3I.
Invisible : _un acteur absent de l’espace public_
Faites le test : essayez de trouver un site web officiel de la COBAC. Il est introuvable ou dysfonctionnel.
Les publications sur le site de la BEAC s’arrêtent en 2018. Depuis plus de cinq ans, aucun rapport d’activité, aucune décision disciplinaire, aucune prise de parole publique.
Pendant ce temps, d’autres régulateurs africains — comme la BCEAO ou l’AMMC au Maroc — publient régulièrement rapports, statistiques et décisions. Ce déficit de visibilité nuit gravement à la crédibilité de la COBAC.
Inaudible : _un silence qui inquiète_
La parole d’un régulateur est essentielle. Elle structure le débat, rassure les épargnants, alerte les professionnels.
Pourtant, lors de l’affaire Oyima — qui a révélé des problèmes de gouvernance majeurs dans un établissement bancaire d’envergure — la COBAC est restée silencieuse. Aucun communiqué, aucune clarification, aucune mesure visible.
Ce silence a été perçu comme une faiblesse, voire une complaisance. Dans l’absence de mots, ce sont les rumeurs qui prospèrent.
Irresponsable : _une régulation qui peine à protéger_
Pourtant, le cadre réglementaire de la COBAC est robuste : ratios prudentiels, exigences de gouvernance, procédures de contrôle.
Mais sur le terrain, l’application de ces règles semble, parfois opaque.
Quand un régulateur ferme les yeux sur des dysfonctionnements, il cesse d’être un arbitre crédible.
Et dans un tel contexte, la confiance dans tout le système s’effrite.
Vers une régulation enracinée : relire EYÔ
Alors, comment faire évoluer la régulation ?
Peut-être faut-il changer de prisme. Dans la tradition d’Afrique centrale, EYÔ est une figure familière : il veille, il observe, il comprend, et quand il parle, c’est pour rétablir l’équilibre.
Inspirons-nous de cette sagesse.
Réguler, ce n’est pas juste contrôler des chiffres. C’est aussi :
- protéger les plus vulnérables,
- garantir un équilibre entre intérêt privé et bien commun,
- et mériter la confiance des citoyens.
Une régulation enracinée, à l’image d’EYÔ, serait :
- Visible, comme une présence bienveillante et claire,
- Audible, comme une voix qui éclaire sans se dérober,
- Responsable, comme une autorité qui rend des comptes et agit avec justesse.
EYÔ : un indice de conformité pour prévenir plutôt que guérir
Dans une décision récente, la COBAC a annoncé le recrutement d’experts dédiés à la liquidation des établissements en faillite. Une décision technique en apparence mais, qui dans les faits est un signal fort envoyé à tout le secteur bancaire et de la microfinance :
- La COBAC renforce ses unités de soins intensifs et palliatifs.
- Elle se prépare à accompagner la mort ordonnée des institutions non viables.
Cette initiative qui s’inscrit dans une démarche proactive de consolidation du système financier régional, montre également une réalité que beaucoup pressentaient : le régulateur se prépare à éteindre, à fermer, à liquider. Si cette décision peut être saluée pour son réalisme opérationnel, elle révèle aussi un vide stratégique en amont : celui de la prévention visible, de la transparence proactive, de la vigilance citoyenne.
Mais faut-il vraiment attendre la chute pour intervenir ?
Nous pensons que non. D’où notre proposition : créer l’indice EYÔ.
Un outil simple, public, accessible, qui permettrait de voir venir les fragilités, d’accompagner les établissements en difficulté, et de redonner du sens à l’action réglementaire.
Trois objectifs clairs :
- Informer et protéger les usagers, avec un repère pédagogique sur la qualité des banques et IMF ;
- Stimuler la discipline sectorielle, en valorisant les bonnes pratiques ;
- Renforcer la supervision, en hiérarchisant les risques et en ciblant les contrôles.
Dans un écosystème souvent opaque, rendre visible la conformité, c’est déjà renforcer la confiance.
Comment fonctionnerait l’indice EYÔ ?
L’indice EYÔ serait publié chaque trimestre et reposerait sur quatre piliers pondérés :
- Conformité réglementaire (40 %) : solvabilité, liquidité, fonds propres ;
- Gouvernance et transparence (25 %) : fonctionnement des organes, audit, publications ;
- Relation client (25 %) : frais bancaires, lisibilité des contrats, traitement des réclamations ;
- Réactivité à la régulation (10 %) : délais de réponse et respect des injonctions.
Chaque établissement aurait une fiche publique. Un portail dédié afficherait les résultats et permettrait aux usagers de comparer.
Un comité indépendant, associant société civile, experts et régulateur, garantirait la crédibilité de l’évaluation.
Un outil gagnant-gagnant-gagnant
Bien conçu, bien diffusé, l’indice EYÔ profiterait à tous.
Pour la COBAC :
- Elle gagne en visibilité, sans avoir à commenter chaque crise.
- Elle hiérarchise les risques et renforce sa légitimité.
- Elle anticipe, au lieu de gérer des urgences.
Pour les banques :
- Un outil de pilotage interne, utile et structurant.
- Une meilleure réputation pour les mieux notées.
- Une dynamique d’émulation, plutôt que de sanction.
Pour les citoyens :
- Une information claire, pour choisir sa banque en connaissance de cause.
- Un levier pour poser des questions, demander des comptes.
- Une confiance retrouvée dans l’écosystème bancaire.
La COBAC à la croisée des chemins
Non, la COBAC n’est pas encore le maillon faible de la CEMAC. Mais elle pourrait vite le devenir.
Son silence face à certaines crises, son absence de dialogue public, son invisibilité numérique… tout cela mine sa légitimité.
Et pourtant, elle peut redevenir un acteur clé de la stabilité régionale, un EYÔ moderne, enraciné et lucide.
Mais cela suppose un changement de posture :
- Voir plus tôt,
- Parler plus fort,
- Agir plus clairement,
- Et protéger plus visiblement.
Les citoyens, les entreprises, les familles confient leurs projets, leurs rêves et aspirations aux institutions financières. La COBAC doit être à la hauteur de cette confiance.
La régulation ne peut plus être un exercice discret, en coulisses. Elle doit être Visible, Audible et Responsable.
L’indice EYÔ est une réponse concrète, simple, pédagogique, enracinée.
Un outil de supervision, mais aussi un baromètre de confiance.
Il appartient désormais à la COBAC de choisir :
s’effacer doucement… ou devenir pleinement EYÔ.
Car la confiance ne se décrète pas.
Elle se construit — par la rigueur, par la parole tenue… et surtout, par le courage.






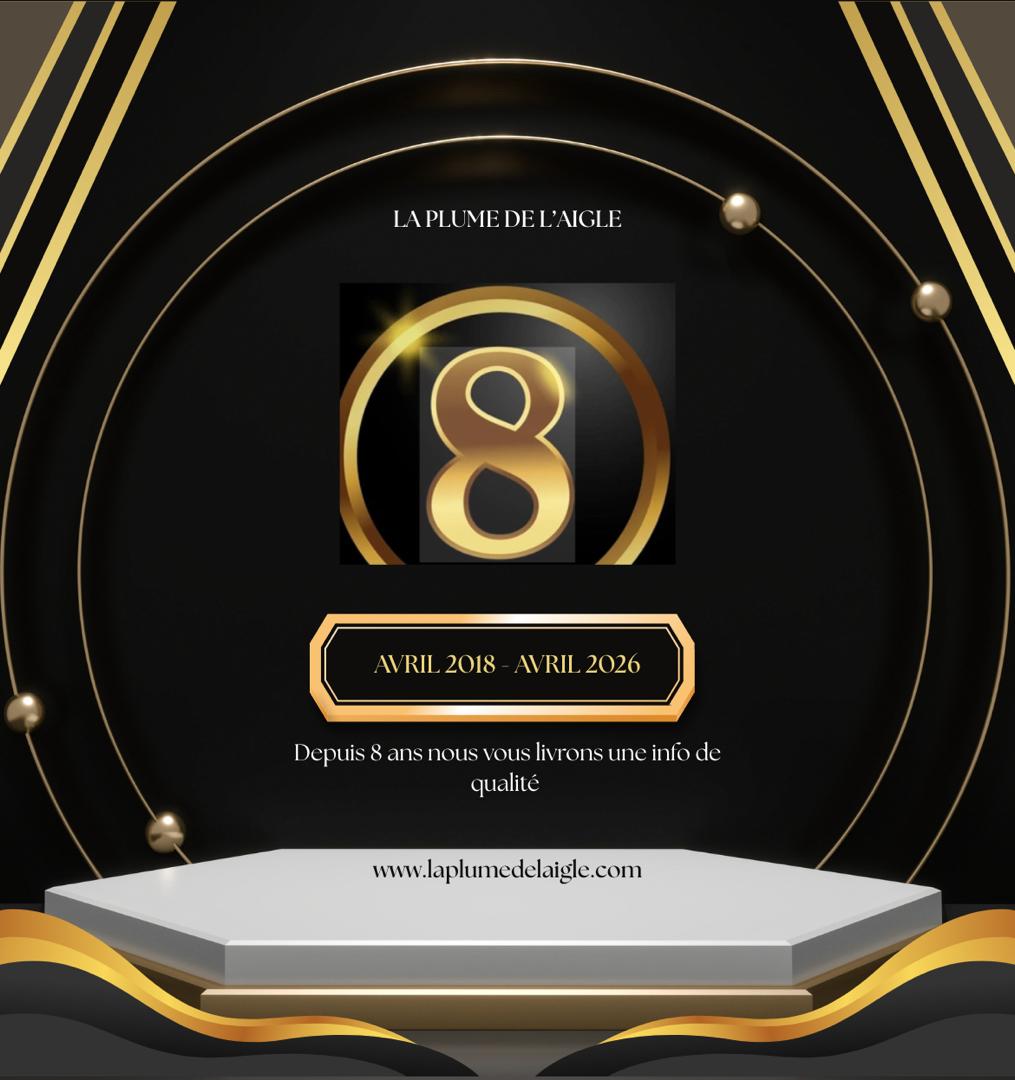

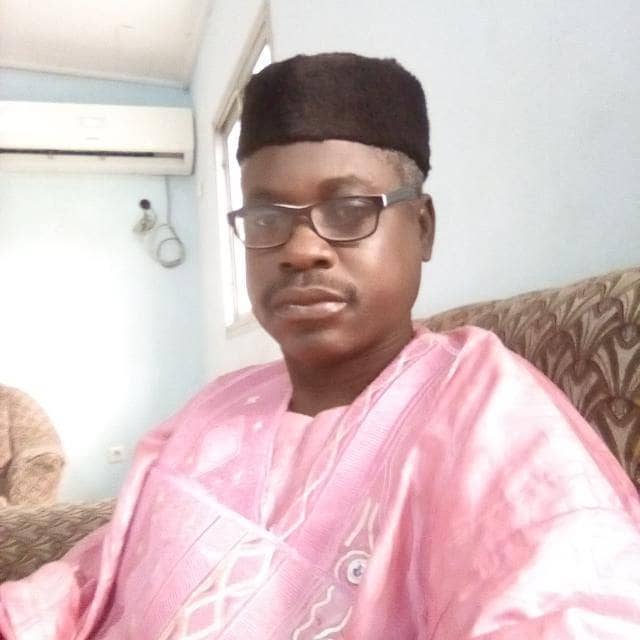




Comments