Sur le thème : « Festival des arts nègres: la construction d’une conscience panafricaine », le rendez-vous est organisé par le Sénégalais El Hadji Malick Ndiaye, chercheur à l’Institut Fondamentale d’Afrique Noire (IFAN) Cheick Anta Diop. Il a animé une conférence mercredi 9 avril à l’Institut Français du Cameroun à Douala. Il est revenu sur les enjeux culturel, politique et symbolique de cet événement du XXe siècle, réunissant intellectuels et militants du continent et de la diaspora pour affirmer, célébrer et questionner l’identité africaine.
Le professionnel des musées El Hadji Malick Ndiaye, ambassadeur des cultures africaines, se ressource au cœur de « l’Afrique en miniature ». L’universitaire sénégalais a échangé mercredi dernier avec les Doualais sur le thème « Festival des arts nègres : construction d’une conscience panafricaine ». Le docteur d’histoire rappelle le mémoire, les dates marquantes de cet événement non sans insister sur son importance.
Le conférencier apprend que le premier festival dédié au continent avait initialement été programmé en 1961, puis repoussé en 1965 et s’est finalement ténu à Dakar au Sénégal du 1er au 24 avril 1966.
Il avait réuni des personnalités de tout horizon. Tous les arts y étaient représentés : art plastique, littérature, musique, danse, cinéma etc. L’Algérie va prendre le relais avec le festival panafricain d’Alger du 21 juillet au 1er août 1969.
Toutes ces dates font dire à El Hadji Malick Ndiaye, qu’il est important de rappeler l’histoire pour plusieurs raisons. « Elle permet de savoir ce qui a existé avant nous et comment cela s’est déroulé, de s’inspirer de ce qui a été afin de mieux appréhender les mécanismes de comment notre monde fonctionne aujourd’hui et de pouvoir analyser et comprendre comment le futur sera structuré », argumente le chercheur.
« Une identité floue »
Aujourd’hui, dans un monde où l’identité africaine devient de plus en plus floue et où la plupart des jeunes sont inconscients, les intellectuels et militants panafricains tendent la ficelle et s’interrogent sur l’impact de ce festival et de son importance. Car disent-ils, il ne trouve pas de place dans le présent de la jeunesse camerounaise en particulier et africaine en général à cause d’une non démocratisation de ces concepts. Face à ce quiproquo, le conférencier El Hadji Malick Ndiaye ne pense pas « qu’on puisse parler d’une identité africaine car c’est dangereux pour deux choses : la première chose est qu’il n’existe pas une identité, mais plusieurs identités africaines ; la deuxième, les identités changent chaque jour. La manière dont on se comporte, dont on a une représentation de notre vie, de la connexion qu’on veut avoir avec nos valeurs tout cela change. L’Afrique est multiple, variée et contradictoire. C’est ce qui fait sa richesse. C’est un débat très intellectuel. À l’époque, les intellectuels n’ont rien fait pour vulgariser leurs pensées pour que ça soit accessible aux populations et villageois d’avant. Et donc nous sommes entrés dans ce débat en tant que jeunes historiens 60 ans plus tard afin de jouer le jeu. Si on devait aller dans les quartiers et villages vulgariser ces concepts ça prendra du temps mais cela sera possible. »
Le festival des arts nègres poursuit sa mission et apparaît donc comme un garant de lutte pour approuver les contributions des artistes noirs et de faire connaître l’apport de la négritude à la civilisation universelle à tous les jeunes d’Afrique et du monde.
Ghislain Ntjam, stagiaire






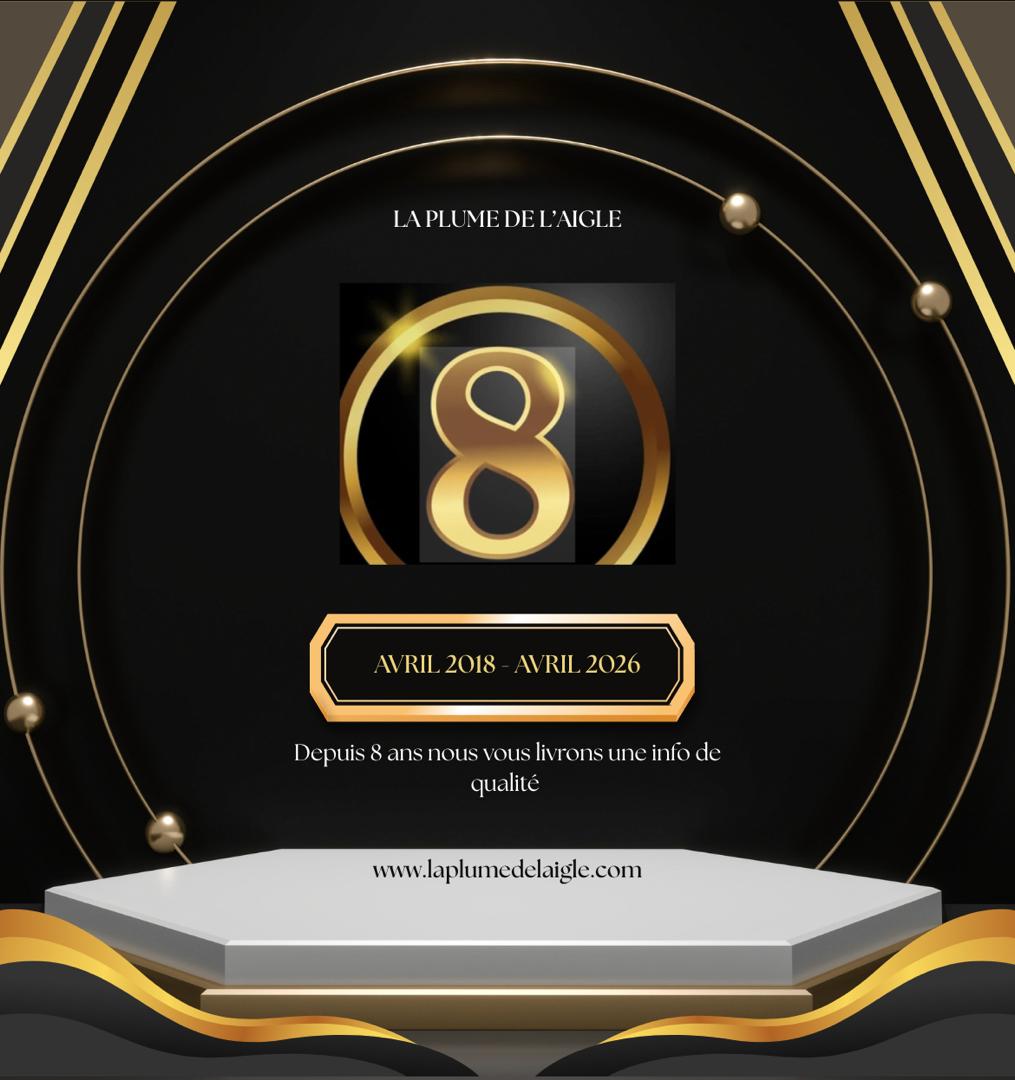



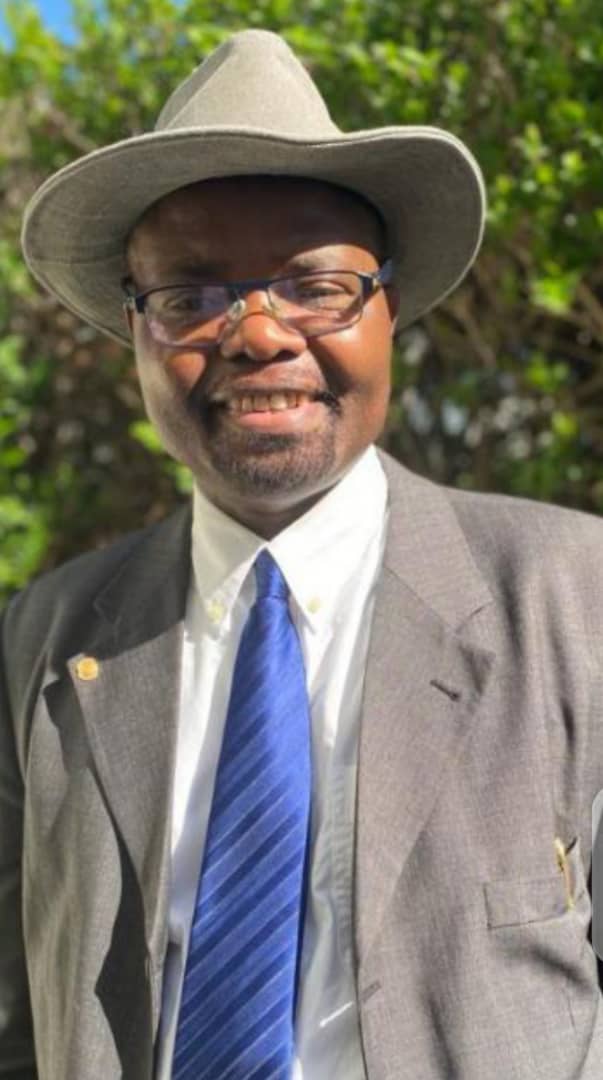


As salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Même si sa pensée est vraie, le simple fait qu’il le fasse avec des français dans un centre appartenant à la France avec quelques soutiens soient ils minables de ceux-ci m’emmène à la déduction que son savoir est utilisé pour diviser et sapper les efforts de construction ou de consolidation de la notion de NATION AFRICAINE et de nourrir des tentions futures et des éclatements favorisant l’affaiblissement de l’effort de libération des africains du joug colonial; son travail est un effort louable et c’est de la recherche, c’est de la science, mais les enjeux sont tels que nous n’avons pas besoin de certaines sciences maintenant c’est pas nécessaire maintenant; si oui , question : comment est ce que la connaissance selon laquelle il ya plusieurs identités africaines peut elle, unir les africains, consolider la patrie africaine sa fratrie, unifier ses efforts, la libérer du joug des impérialistes, de l’exploitation esclavagisante et booster son développement?
Certains savoirs ne nous sont pas utiles maintenant.
Transmettez mes paroles à notre jeune frère sénégalais El Hadji Malick Ndiaye .
Qu’Allah lui accorde une bonne récompense et le bénisse avec une orientation plus élevée
Imam Akono