François Bayrou a récemment rappelé, par une formule devenue rituelle, que la dette publique française « augmente de 5 000 euros par seconde », soit environ 3,28 millions de francs CFA par seconde. Le signal, brutal, repose sur des chiffres nets : à la fin du premier trimestre 2025, l’endettement de l’État atteint 3 345,8 milliards d’euros, soit environ 2 194 701 milliards de francs CFA. Le seul service de cette dette, les intérêts, absorbe chaque année environ 55 milliards d’euros, soit près de 36 078 milliards de francs CFA, un montant supérieur aux budgets cumulés de la Justice et de l’Intérieur. Dans ce contexte de contrainte budgétaire sévère, la pérennité d’instruments de coopération comme le Contrat de désendettement et de développement (C2D) se pose avec acuité. Ce mécanisme qui recycle la dette de pays africains en financements de projets demeure-t-il un outil de solidarité réfléchi ou un reliquat d’influence à repenser face à une Afrique en recomposition géopolitique ?
Le C2D, ou l’art de la recyclerie financière
Conçu au début des années 2000, le C2D repose sur une mécanique vertueuse en apparence. Les pays bénéficiaires, une quinzaine dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et la République démocratique du Congo, paient le service de leur dette antérieure à la France. Paris reverse ensuite l’intégralité des sommes perçues sous forme de dons, affectés à des projets décidés d’un commun accord : santé, éducation, infrastructures rurales.
Les montants peuvent être significatifs. Fin 2022, la Côte d’Ivoire avait reçu 1 213 milliards de francs CFA, soit environ 1,85 milliard d’euros, représentant plus de 90 % des engagements. Sur le terrain, ces fonds servent à construire des centres de santé, à goudronner des routes et à soutenir des projets tangibles. Pour les trésors publics africains, ces transferts apportent un répit financier tout en renforçant une discipline budgétaire. Pour la France, le C2D fonctionne comme un levier d’influence à moindre coût, permettant de soutenir des réseaux et des normes techniques.
Mais cette ingénierie n’élimine pas toutes les ambivalences. Une partie importante des fonds retourne, en bout de chaîne, vers des bureaux d’études et des entreprises françaises chargés d’exécuter les projets. S’il n’y a pas d’illégitimité formelle à cette logique, elle alimente le soupçon d’une aide en circuit fermé, plus profitable au prestige et à l’économie française qu’à l’essor structurel des partenaires. Face aux besoins massifs du continent — le déficit infrastructurel est estimé à plus de 100 milliards de dollars par an, soit autour de 60 000 milliards de francs CFA si l’on retient un ordre de grandeur de 1 dollar ≈ 600 francs CFA — ces montants restent marginaux. Ils paraissent dérisoires comparés aux 36 078 milliards de francs CFA annuels consacrés par la France au seul service de sa dette.
La fracture sahélienne : la fin d’une ère postcoloniale
La faille majeure est davantage politique qu’économique. Le dispositif du C2D suppose un consensus minimal, l’acceptation par les pays partenaires du cadre proposé. Ce consensus se fissure nettement au Sahel. L’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) a fait de la rupture avec le franc CFA un marqueur de souveraineté retrouvée. Ce rejet monétaire s’étend aux instruments financiers perçus comme des prolongements de cette tutelle, rendant le C2D dans certains discours difficilement acceptable.
Cette défiance s’inscrit dans une recomposition plus vaste des alliances africaines. L’élargissement des BRICS, avec l’entrée de l’Égypte et de l’Éthiopie et l’influence accrue de l’Arabie saoudite et des Émirats, offre des alternatives. Moscou, Pékin, Ankara et New Delhi proposent des prêts aux conditions différentes, des investissements directs et un discours de partenariat sud-sud qui tranche avec celui des bailleurs traditionnels. La signature d’accords militaires entre certains États africains et des partenaires extérieurs illustre cette diversification stratégique qui dépasse le seul registre économique.
L’onde de choc ukrainienne : accélérateur de tensions
La guerre en Ukraine a agi comme un catalyseur. En provoquant la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, elle a précipité plusieurs économies africaines déjà fragiles vers des situations critiques. Parallèlement, la réaction des banques centrales occidentales, avec une remontée des taux, a alourdi le fardeau du service de la dette pour de nombreux pays.
La France, elle-même confrontée à un déficit public marqué, se retrouve prise entre la montée des besoins domestiques et la volonté de préserver des instruments d’influence. Comment maintenir auprès d’une opinion publique attentive à la qualité des services publics et à la pression fiscale des dispositifs de recyclage de dettes pour des pays qui affichent une volonté de diversification ? La question dépasse le seul calcul comptable pour devenir nettement politique.
Un système à repenser
Le C2D se tient à un carrefour. Il incarne la tension de la politique africaine de la France, tiraillée entre une ambition de solidarité et une logique de realpolitik visant à maintenir des intérêts et des standards. Pour Paris, le mécanisme conserve de la valeur pour préserver un ancrage et un dialogue dans des pays où son influence recule face à la multipolarité.
Pour des capitales africaines de plus en plus affirmées, le C2D semble cependant de moins en moins adapté. Une jeunesse connectée et exigeante réclame des partenariats d’égal à égal plutôt que des mécanismes hérités d’un autre temps. Par ailleurs, la persistance de la dette française affaiblit la crédibilité d’un discours sur la rigueur budgétaire.
La critique majeure adressée au C2D porte moins sur son efficacité opérationnelle que sur son adéquation au nouveau contexte géopolitique. Il symbolise une tentative de maintenir une influence par la technocratie alors que le moment demande reconnaissance et respect. Face aux remises en cause monétaires et à la réorganisation des alliances internationales, Paris est confronté à une alternative : abandonner, réformer profondément ou remplacer cet instrument par un dispositif qui réponde aux aspirations actuelles. La décision déterminera si la France demeure entendue ou si elle assiste, impuissante, à une réorientation du continent.
Enjeu pour le Cameroun à la veille de la présidentielle
À quelques jours de l’élection présidentielle, la question du C2D prend une dimension immédiate pour le Cameroun, bénéficiaire régulier de ces financements. Les projets financés par le mécanisme touchent des secteurs sensibles pour l’électorat : santé, éducation et infrastructures routières. L’incertitude liée à la recomposition des partenaires internationaux peut ralentir les décaissements, compromettre l’achèvement de chantiers visibles et nourrir des critiques politiques sur la gouvernance des fonds.
Dans un contexte électoral, les enjeux sont multiples. Le déroulement des projets influence la perception de l’action publique et peut servir de terrain de débat entre candidats. La dépendance à des mécanismes externes soulève des questions sur la capacité de l’État à répondre aux besoins immédiats de la population. Par ailleurs, l’attractivité croissante d’alternatives extérieures peut transformer les options de coopération et devenir un argument de campagne sur la souveraineté économique. Ces dynamiques rendent la gestion et la communication autour du C2D des éléments déterminants pour la stabilité et la crédibilité des autorités en place pendant et après la période électorale.






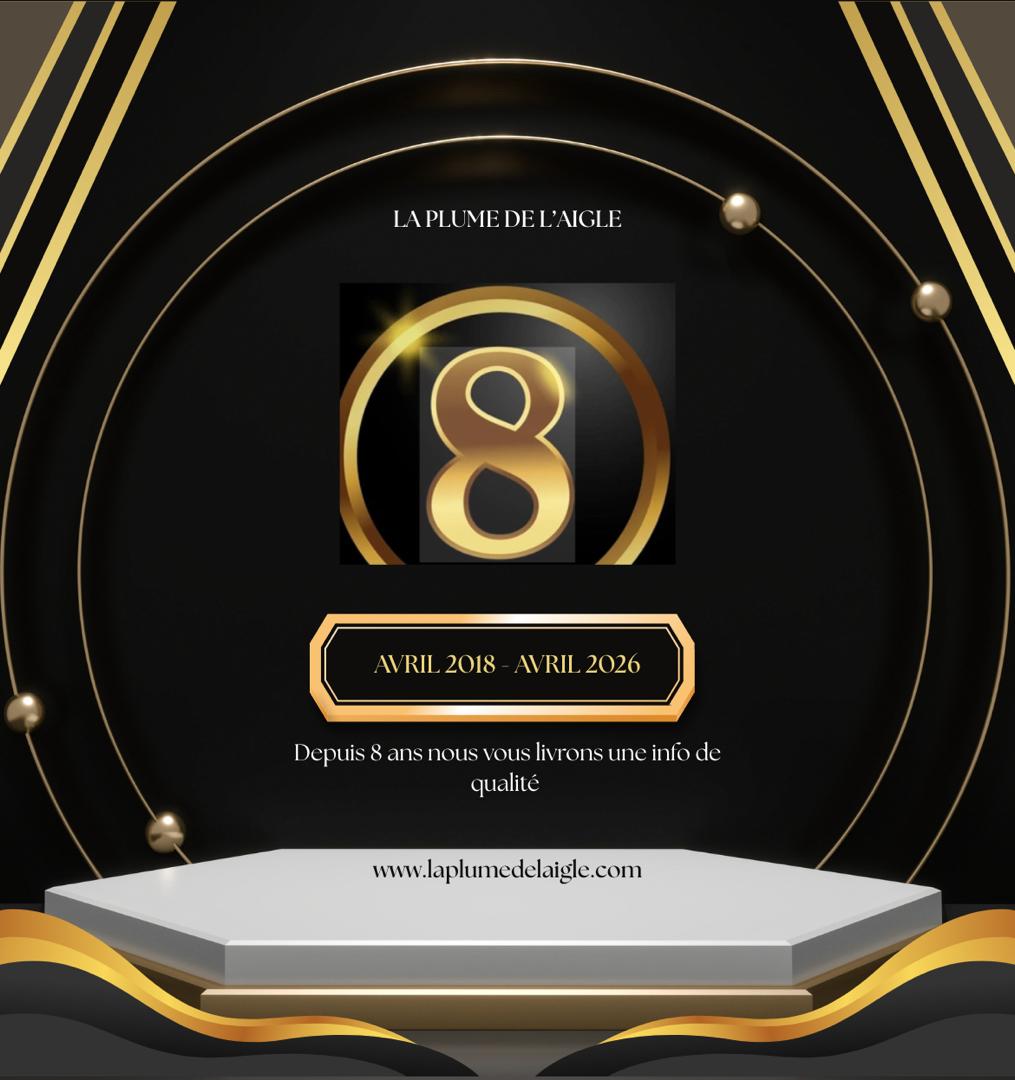






Comments