_Un pays en attente : les maux derrière les mots de la circulaire 2026._
_Par– Charles Menye Président du Comité Citoyen de Vigilance Financière – CEMAC (CFVC) _
Une circulaire technique pour une réalité sociale tendue
Le 18 juillet 2025, la présidence de la République du Cameroun a signé la circulaire budgétaire fixant les grandes orientations pour l’élaboration du budget de l’État en 2026. Sur la forme, le document adopte un ton technocratique, presque neutre. Il y est question de « rationalisation des dépenses »_, de _« maîtrise de la masse salariale »_ de “priorisation” des projets et d’“efficience” budgétaire.
Autant de termes empruntés au langage des experts, qui donnent l’impression d’un État soucieux de rigueur et de bonne gestion.
Mais une lecture attentive révèle une tout autre réalité. Car derrière ces mots feutrés, ce que la circulaire ne dit pas explicitement saute pourtant aux yeux : le Cameroun est financièrement à bout de souffle.
L’État est contraint par le poids croissant de sa dette, les engagements internationaux, et la pression constante des besoins sociaux non couverts. Chaque franc mobilisé appelle désormais des choix difficiles : embaucher un enseignant ou acheter du matériel médical ? Réparer une route rurale ou payer les intérêts d’un emprunt ? Subventionner l’eau potable ou solder une facture due à un prestataire étranger ?
En réalité, cette circulaire est moins un instrument de pilotage qu’un aveu discret d’impuissance.
Elle décrit un État dont la marge de manœuvre est de plus en plus réduite, obligé d’opérer des arbitrages douloureux, souvent invisibles pour la population, mais lourds de conséquences au quotidien. Ce que le document présente comme une stratégie d’“efficience” n’est souvent qu’un habillage pudique de l’austérité. Moins de recrutements, gel des projets sociaux, restrictions sur les équipements… autant de mesures qui, traduites dans la vie réelle, signifient des salles de classe sans enseignants, des centres de santé sans personnel, des quartiers sans éclairage ni eau.
C’est pourquoi cette circulaire, bien que technique dans sa forme, a une portée éminemment politique. Elle dessine les contours d’un mandat présidentiel sous contrainte. Le futur chef de l’État camerounais devra non seulement faire face à une situation budgétaire tendue, mais aussi à une population de plus en plus consciente, exigeante, et en attente de résultats tangibles.
Gouverner en 2026, ce ne sera pas seulement équilibrer les comptes : ce sera faire des choix courageux, expliquer, arbitrer… et surtout, rendre des comptes.
Une dette publique massive… mais peu utile : le fardeau des générations sacrifiées
En l’espace de quinze ans, la dette publique du Cameroun est passée de 2 000 milliards FCFA en 2010 à plus de 12 000 milliards FCFA en 2024. Soit une multiplication par six. En soi, contracter de la dette n’est pas un problème : c’est même un outil de développement lorsqu’elle sert à financer des infrastructures utiles, rentables ou socialement transformatrices.
Mais le drame camerounais, c’est que cette dette n’a pas tenu ses promesses. Elle est visible dans les bilans comptables…mais invisibles dans la vie des citoyens. Elle a financé des projets qui peinent à voir le jour où qui reste partiellement opérationnels :
- L’autoroute Douala–Yaoundé, lancée en 2014, censée fluidifier le corridor économique du pays, n’est toujours pas achevée en 2025. Sur 215 km prévus, moins de la moitié est utilisable.
- Le barrage de Memve’ele, annoncé comme une réponse à la crise énergétique, n’a toujours pas permis d’atteindre l’autosuffisance. Certaines régions, comme l’Extrême-Nord, restent plongées dans le noir plus de 12h par jour.
- À Yaoundé, la capitale, l’eau potable reste un luxe. Des quartiers comme Mendong, Nkolbisson ou Etoudi subissent des coupures quotidiennes, malgré les projets financés par emprunt auprès de bailleurs comme la Banque mondiale.
Ce sont là des dettes vivantes. Elles vivent dans le quotidien de Delphine, vendeuse de poisson à Douala, qui perd une partie de sa marchandise chaque jour faute de glace ou de courant. Elles vivent dans le silence d’une salle de classe vide à Ngaoundéré, où l’enseignant promis n’est jamais arrivé. Elles vivent dans les décisions douloureuses des parents qui doivent choisir entre l’achat de médicaments et la scolarisation d’un enfant.
La circulaire présidentielle évoque, à la page 7, la nécessité que « _les nouveaux engagements budgétaires prennent en compte la soutenabilité de la dette publique »_. Mais à aucun moment elle ne remet en question les dettes passées, leur pertinence, ou leur impact social réel. Pourtant, il serait irresponsable de continuer à empiler des dettes sans interroger la qualité des projets réalisés et leur rentabilité pour le pays.
Cette absence d’évaluation transforme la dette camerounaise en malédiction transgénérationnelle. Car ce ne sont pas seulement les citoyens d’aujourd’hui qui paient : ce sont aussi leurs enfants. En remboursant les dettes par des coupes budgétaires dans l’éducation, la santé, ou l’agriculture, on hypothèque l’avenir d’un peuple. On sacrifie des générations pour des infrastructures inutiles, parfois même inutilisées.
Il est urgent d’auditer ces dettes. Non pas pour désigner des coupables uniquement, mais pour comprendre, corriger, et reconstruire. Le vrai redressement ne viendra pas d’une simple réduction des dépenses : il viendra d’un changement radical de rapport à l’endettement, où chaque franc emprunté devra désormais prouver sa raison d’être.
Moins d’argent pour les services publics : la tempête de l’austérité approche
La circulaire présidentielle du 18 juillet 2025 n’est pas seulement un document de cadrage budgétaire. Elle est aussi le vent qui annonce la tempête de l’austérité. Derrière les mots feutrés – « maîtrise des charges », « rationalisation des dépenses », « réduction de la masse salariale » – se cache une réalité brutale : l’État camerounais se prépare à faire moins… avec moins.
En clair, cela signifie :
- Moins de recrutements dans la fonction publique, alors que des milliers de jeunes enseignants, infirmiers, ingénieurs ou techniciens attendent d’être intégrés.
- Moins de moyens pour les équipements sociaux, alors que nombre d’écoles rurales fonctionnent encore sous des hangars en tôle et que les centres de santé manquent de matériel basique.
- Des projets reportés sine die, malgré les promesses électorales ou les besoins urgents des populations.
Sur le papier, la circulaire appelle à « prioriser les dépenses critiques » (p. 9). Mais cette notion reste vague, presque insaisissable. Qui décide de ce qui est “critique” ? Et surtout : critique pour qui ?
Est-ce la réhabilitation d’un hôpital à Maroua ? La construction d’un pont dans l’Est ? La connexion d’un lycée à l’électricité à Abong-Mbang ? Ou simplement le paiement à temps des enseignant vacataires ?
Ce flou laisse craindre que les arbitrages budgétaires continuent de privilégier les ministères “stratégiques” (défense, sécurité, présidence), au détriment des besoins sociaux urgents.
Le citoyen, lui, ressentira l’austérité de manière concrète et douloureuse :
- Une mère qui accouche sans sage-femme disponible.
- Un enfant qui étudie sans table ni lumière.
- Un agriculteur bloqué par une piste impraticable en saison des pluies.
L’austérité, ce ne sont pas que des lignes comptables. Ce sont des vies ralenties, des espoirs suspendus, des générations bloquées, des enfants morts. Et lorsqu’elle frappe un État déjà affaibli, sans filet social solide, elle peut devenir un facteur d’exclusion, d’instabilité, voire de radicalisation silencieuse.
Il ne s’agit pas de nier la nécessité de mieux utiliser l’argent public. Mais si l’on coupe dans les dépenses sans repenser les priorités, on fabrique un avenir encore plus fragile. La rigueur budgétaire, si elle est imposée sans justice, devient une punition collective pour les plus vulnérables.
Un service public vidé de sa substance
Même là où les infrastructures existent, les moyens de fonctionnement ne suivent pas. Les hôpitaux manquent de médicaments, les enseignants sont affectés dans des zones sans logement, les agents techniques désertent les postes ruraux. Le service public survit, mais il ne fonctionne plus.
Le prochain président devra relever un défi immense : _redonner corps à un État capable de répondre aux besoins essentiels, de manière décentralisée, humaine et efficace._
Une fiscalité inefficace… et profondément injuste
Le système fiscal camerounais repose encore massivement sur la TVA, cet impôt indirect que tout le monde paie, riche ou pauvre, à chaque achat quotidien. Acheter un sac de riz, une boîte de sardines ou même un cahier pour son enfant revient à contribuer à l’État… sans distinction de revenu. Ainsi, une vendeuse de beignets paie proportionnellement plus d’impôts qu’un grand propriétaire foncier non déclaré.
Pendant ce temps, d’autres sources potentielles de recettes – comme la fiscalité foncière, les revenus locatifs, ou les rentes minières – sont très peu exploitées. Les grandes fortunes, les propriétaires immobiliers et les entreprises bien connectées parviennent souvent à passer sous les radars du fisc. Le résultat est doublement problématique : les recettes fiscales restent faibles, et le système est perçu comme profondément injuste.
Or, sans ressources propres, pas de services publics dignes. Et sans équité, pas de légitimité fiscale.
Il ne suffit donc plus de “traquer les fraudeurs” ou d’augmenter la TVA : il faut changer de logique. Passer d’une administration fiscale de contrôle et de suspicion, à une administration des contributions, fondée sur la transparence, la simplification et la responsabilité partagée.
Dans cette nouvelle approche, chacun – particulier, commerçant, entreprise, collectivité – comprend clairement pourquoi il paie, comment il paie, et surtout ce à quoi servent ses contributions. Le citoyen devient alors acteur du financement public, et non simple cible fiscale.
Réformer le système fiscal, c’est donc réconcilier l’État et ses citoyens autour d’un pacte de justice et de responsabilité. Un chantier complexe, car il faudra affronter des lobbys puissants, mais un passage obligé pour sortir durablement de la dépendance à la dette.
Le malaise social en toile de fond
La circulaire présidentielle martèle la nécessité d’“efficience budgétaire”. Mais dans les rues de Douala, de Garoua ou d’Ebolowa, ce mot ne résonne pas. Ce que les citoyens voient, ce sont des écoles délabrées, des centres de santé sans personnel, des routes rurales impraticables. Ce qu’ils vivent, c’est la hausse continue des prix, la rareté des petits emplois, l’angoisse quotidienne de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de base.
Les jeunes, notamment, étouffent sous le poids d’un avenir sans perspective. Diplômés mais sans emploi, souvent contraints à l’informel ou à l’exil, ils regardent les discours d’austérité comme des promesses vides. La frustration sociale grandit, silencieuse mais profonde, surtout quand les élites politiques semblent protégées des efforts demandés au reste de la population.
Or, une société qui se sent oubliée peut, un jour, cesser d’obéir. L’instabilité ne vient pas toujours des oppositions organisées ; elle surgit parfois d’une étincelle imprévisible dans une foule désabusée.
C’est pourquoi gouverner, ce n’est pas seulement équilibrer des tableaux Excel. C’est entendre ce que disent les silences, anticiper les colères, réparer le lien entre l’État et ses citoyens. C’est assumer une responsabilité humaine, pas seulement comptable.
Le prochain président devra donc aller au-delà des chiffres. Il lui faudra inventer un nouveau pacte social, capable de concilier rigueur budgétaire et justice sociale. Cela signifie faire des choix courageux : couper les dépenses de prestige plutôt que les services de proximité, renégocier certaines dettes pour mieux financer les besoins urgents, et surtout restaurer la parole et la confiance.
Car un budget équilibré sans paix sociale n’est qu’une illusion temporaire. L’équilibre véritable est celui qui permet à chaque citoyen de se sentir compté… et entendu.
Un budget encore trop opaque : pour une gouvernance VAR
Dans les faits, le budget de l’État reste l’affaire d’un cercle fermé d’experts et de technocrates. Les grandes décisions budgétaires sont prises loin du regard du citoyen, et les indicateurs de performance se résument souvent à un chiffre trompeur : le taux de décaissement. Or, décaisser ne veut pas dire impacter. Le citoyen, lui, attend des résultats visibles dans sa vie quotidienne : une école ouverte, une route entretenue, un centre de santé équipé.
La circulaire elle-même le reconnaît : _« Il est indispensable de renforcer le lien entre les ressources mobilisées et les résultats atteints »_ (p. 5). Mais cette lucidité restera vaine sans un changement de culture budgétaire.
C’est pourquoi le Comité Citoyen de Vigilance Financière – CEMAC appelle à une nouvelle approche, fondée sur un budget VAR : Visible, Audible, Responsable.
- Visible, car les informations budgétaires doivent être accessibles, lisibles, et régulièrement publiées ;
- Audible, car les citoyens doivent pouvoir exprimer leurs priorités, questionner les choix, et participer au débat public ;
- Responsable, car les gestionnaires publics doivent rendre compte des résultats, corriger les écarts, et assumer les conséquences de leurs décisions.
Un tel budget n’est pas une utopie. C’est une nécessité démocratique dans un contexte où la confiance s’effrite et où chaque franc public doit produire un impact réel. Sans transparence ni reddition de comptes, la rigueur budgétaire risque de devenir une punition injuste au lieu d’un levier de transformation.
Des annonces d’investissements peu crédibles
Alors même que la circulaire présidentielle appelle à la rigueur, à la discipline budgétaire et à la sélection prudente des investissements, le gouvernement annonçait en parallèle un plan d’investissement public pour le triennat 2025–2027 d’une ampleur inédite : 74 projets majeurs, pour un montant total dépassant 25 000 milliards FCFA, dont 63 % à la charge de l’État.
Les domaines concernés sont stratégiques : énergie, routes, infrastructures agricoles, réseau ferroviaire… Autant de secteurs en souffrance, où les besoins sont réels et urgents. Mais cette ambition soulève de sérieuses interrogations.
Comment financer de tels projets, alors que le budget d’investissement public annuel plafonne autour de 1 800 milliards FCFA, et que la soutenabilité de la dette est déjà une source d’inquiétude clairement mentionnée dans la circulaire elle-même ? Peut-on raisonnablement croire que l’État, dans sa configuration actuelle, puisse mobiliser en trois ans plus de 15 000 milliards FCFA de ressources domestiques ou empruntées sans aggraver les déséquilibres ?
La circulaire, pourtant, est explicite : les projets doivent être « sélectionnés sur la base de leur niveau de maturité, de leur faisabilité financière et de leur impact » (page 11). Cela suppose une rupture nette avec les habitudes passées où on annonce d’abord, on étudie ensuite, et on finance à perte.
Le risque est grand que ces annonces ne relèvent d’un nouveau « budget spectacle », fait pour séduire à l’approche d’une échéance électorale, sans tenir compte des contraintes techniques, financières et sociales du pays.
Trop souvent, les projets d’envergure, mal préparés, mal gérés et mal suivis, deviennent des poches de dette et des sources de frustration populaire.
L’enjeu est donc clair : ne plus confondre ambition et démesure. Un bon projet, ce n’est pas celui qui brille sur une affiche, mais celui qui fonctionne au quotidien pour les citoyens. L’État gagnerait à faire moins, mais à faire mieux — en priorisant les projets réalistes, bien conçus, à impact rapide et mesurable.
Joindre les actes à la parole, c’est faire preuve de cohérence budgétaire, mais aussi de respect pour les contribuables, qui financent ces investissements à travers leurs impôts… et leurs sacrifices.
Un mandat sous contrainte, mais pas sans espoir
Le prochain président du Cameroun ne partira pas d’une page blanche. Il prendra les commandes d’un pays financièrement sous tension, où les marges de manœuvre sont étroites, et où chaque décision budgétaire devra conjuguer rigueur, justice et efficacité. Il héritera d’un stock de dettes élevé, contractées au fil des années souvent sans transparence ni résultats probants. Il fera face à un budget comprimé, où les dépenses incompressibles (salaires, service de la dette) laissent peu de place à l’investissement utile. Il devra redonner vie à un service public affaibli, dont les infrastructures existent mais dont les moyens humains et techniques manquent. Enfin, il devra composer avec une jeunesse impatiente, qui ne croit plus aux promesses abstraites et qui attend des actes concrets.
Mais ces contraintes ne doivent pas être vues uniquement comme des obstacles. Elles peuvent aussi être le point de départ d’un tournant historique. Car gouverner dans la difficulté, c’est parfois l’opportunité de faire différemment, de poser les bases d’un nouveau contrat budgétaire entre l’État et les citoyens.
Il ne s’agira plus simplement de réduire des déficits ou de satisfaire les bailleurs, mais de donner un sens à chaque franc dépensé, de réorienter le budget vers les urgences sociales, et surtout de rétablir la confiance du peuple envers ses institutions. Cela suppose du courage, de la méthode, et une volonté réelle de rupture avec les logiques du passé.
Ce mandat ne sera ni confortable, ni facile. Mais il peut marquer la fin d’un cycle de déconnexion entre la parole publique et la réalité vécue, et le début d’un budget de reconstruction, orienté vers le bien commun et la justice sociale.
À condition de ne plus cacher les maux derrière les mots.
Ce que propose le Comité Citoyen de Vigilance Financière – CEMAC
Le futur président camerounais devra faire des choix forts. Voici quatre propositions concrètes pour redonner au budget sa fonction première : servir l’intérêt général.
- Réaliser un audit indépendant des dettes contractées depuis 2010
La dette publique du Cameroun a explosé ces quinze dernières années, passant de 2 000 à plus de 12 000 milliards FCFA. Pourtant, le citoyen ne voit pas les bénéfices à la hauteur des emprunts : projets inachevés, infrastructures sous-utilisées, surfacturations.
Un audit rigoureux, mené par des instances indépendantes, permettrait de distinguer les dettes utiles de celles qui relèvent du gaspillage ou de la mauvaise gouvernance. Cela ouvrirait la voie à une renégociation intelligente des échéances et à une responsabilisation des décideurs.
- Réorienter les dépenses publiques vers les services essentiels (éducation, santé, eau)
La circulaire appelle à “rationaliser les charges de fonctionnement”, ce qui peut se traduire par des gels de recrutement ou la réduction des moyens alloués aux services publics. Or, ce sont justement ces secteurs – hôpitaux, écoles, accès à l’eau – qui touchent le quotidien des Camerounais.
Il est donc impératif de faire de ces services une priorité absolue dans l’allocation budgétaire, quitte à reporter des projets moins urgents. Une école fonctionnelle vaut parfois mieux qu’une infrastructure spectaculaire sans impact réel.
- Impliquer les citoyens dans la planification et le suivi du budget
En créant des espaces de participation citoyenne (comités locaux, plateformes numériques, consultations publiques), on peut mieux identifier les priorités locales, suivre l’exécution des projets, et restaurer la confiance dans la gestion des fonds publics.
- Engager un dialogue sincère avec les bailleurs pour sortir du pilotage comptable
Les partenaires financiers internationaux (FMI, Banque mondiale, etc.) imposent souvent des règles strictes, centrées sur les équilibres budgétaires à court terme. Cela oblige parfois l’État à faire des arbitrages douloureux, au détriment des besoins sociaux.
Il est temps de rééquilibrer cette relation en affirmant une vision nationale de développement : défendre des projets réellement utiles, négocier des marges de flexibilité, et sortir d’une logique où l’objectif principal est de rassurer les marchés plutôt que de répondre aux urgences sociales.
Conclusion – Une occasion historique de reconstruire la confiance
Au terme de ce décryptage, une vérité s’impose : la circulaire budgétaire 2026 ne dit pas tout, mais elle révèle l’essentiel. Elle dessine les contours d’un pays à bout de souffle… mais pas à bout d’élan. Car au cœur de la contrainte, une opportunité historique se présente : celle de reconstruire un État à hauteur d’homme, et un budget à hauteur de citoyen.
Le prochain président n’aura peut-être pas les mains libres, mais il peut avoir les mains propres. Il peut inaugurer un temps nouveau, où chaque franc public est investi avec discernement, chaque politique est évaluée avec rigueur, et chaque citoyen est respecté comme contributeur et acteur du bien commun.
Ce que demandent les Camerounais n’est pas une faveur : c’est un droit. Le droit à l’eau potable, à un service de santé digne, à une école qui fonctionne, à une route praticable. Mais plus encore : ils demandent à retrouver leur honneur, à regagner leur fierté d’appartenir à une nation qui les considère. Pas dans une arrogance stérile ou des slogans vides, mais dans le concret d’un hôpital qui soigne, d’un impôt qui sert, d’un budget qui transforme.
Ce que propose le Comité Citoyen de Vigilance Financière – CEMAC, c’est un contrat nouveau entre l’État et les citoyens : un budget Visible, Audible et Responsable, un endettement utile et mesuré, une fiscalité équitable, et des choix politiques alignés avec les urgences sociales.
Car gouverner demain ne consistera pas seulement à équilibrer les comptes : il s’agira de rétablir un lien brisé, de rendre des comptes… et surtout, de rendre sa dignité à tout un peuple.
C’est cela, la vraie réforme. Et c’est possible, ici et maintenant.






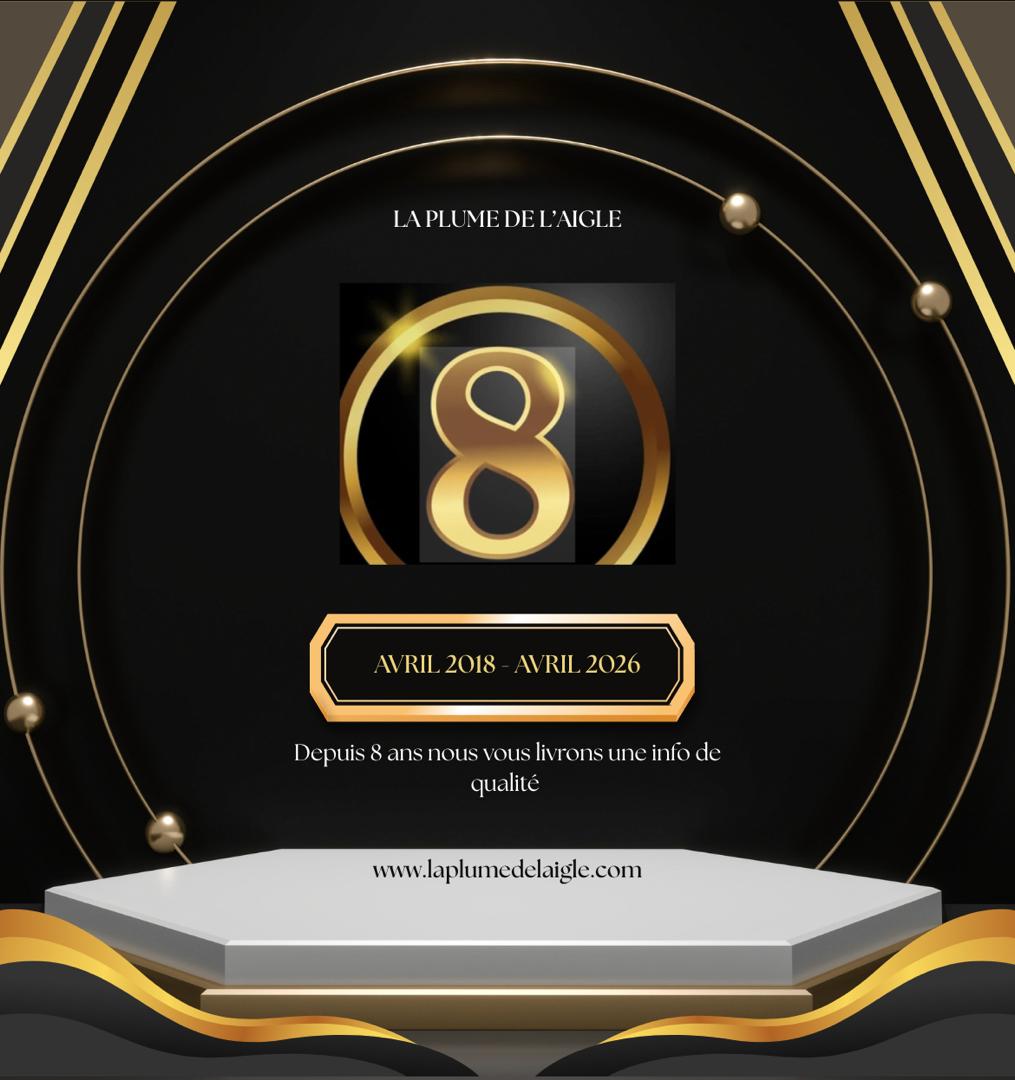



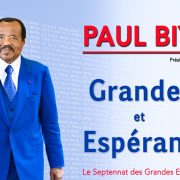


Comments