Tribune – C’est connu de tous! L’agriculture est la colonne vertébrale de l’économie nationale. Plus de 60% de la population en vit.
Bon à savoir, Agriculture est un terme générique qui désigne également la pêche et l’élevage. A l’approche du scrutin du 12 octobre prochain, où en est ce secteur d’activité, prometteur en emploi, en sécurité alimentaire et en devises?
Pour répondre à cette question, nous nous pencherons, dans un premier temps, sur les cultures à fort impact socio-économique, à savoir le maïs, le riz, la banane-plantain, le blé, le haricot, l’huile de palme, le cacao, le coton, le café, puis dans un second temps, nous analyserons les filières poisson et avicole.
Cependant, un préalable s’impose puisqu’incontournable, c’est :
– Le changement climatique.
Tout programme de candidat qui ne traite pas de cet impératif est un programme agricole fantaisiste. Son ou ses auteurs sont à éviter dans les urnes, car quiconque s’amuse avec l’agriculture s’amusera avec l’avenir des Camerounais.
Le changement climatique impacte sévèrement la production agricole, pastorale et halieutique. Il convient:
– de vulgarisation les mesures d’adaptation,
– de vulgariser les bulletins d’alerte climatique,
– de renforcer les moyens des structures météorologiques (DMN, ONACC),
– De répertorier les pertes agricoles liées au changement climatique, ensuite indemniser les victimes.
En amont, il faudra renforcer la sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles et autres dispositifs protecteurs de l’environnement.
Culture de rente
Le Cameroun n’en tire pas suffisamment profit, en raison, d’une part, d’une transformation mièvre, et d’autre part, d’une compétitivité entravée par les coûts de production élevés et une communication insuffisante.
Pour le cas du cacao, les producteurs ne reçoivent que 2% de la masse monétaire générée annuellement par l’industrie mondiale chocolatière, évaluée à plus de 100 milliards de dollars (c’est bien dollars).
Malgré la formidable embellie, beaucoup d’argent échappent au Cameroun. Pire, le pays est exposé aux chocs exogènes tels les fluctuations des cours mondiaux de cacao.
Concernant le coton, plus de 50% de la production nationale est exportée sans transformation sur place. Or, en agriculture, la plus-value réside dans la transformation. Qui produit sans transformer s’appauvrit. Il convient pour ces deux filières, à laquelle s’ajoute le café :
– d’accroître le tonnage,
– de transformer plus,
– de réduire les coûts de production, afin de rendre le produit fini compétitif,
– d’interdire progressivement la friperie,
– de limiter les importations des produits finis, au profit de leurs équivalents locaux,
– de soutenir les champions nationaux.
Agriculture vivrière
Le Cameroun dépense des milliards, chaque année, pour acheter à l’étranger ce qu’il peut produire sur place.
Selon l’Institut national de la statistique (INS), la facture, en 2024, s’élève à 230 milliards pour le blé. 320 milliards pour le riz. Pour ce dernier produit, le Cameroun a dépensé, ces 5 dernières années – c’est-à-dire entre 2019 et 2024 – 1153, 9 milliards ( mille cent cinquante trois milliards neuf cent millions) FCFA en exportation. Pour limiter la saignée, il convient :
– d’accroître la production de farines locales (patate, manioc, igname…) et de les incorporer, progressivement, dans du pain, des biscuits et autres denrées à base de blé,
– de soutenir les vrais agriculteurs,
– de multiplier les unités de décorticage de riz,
– de subventionner les produits locaux, afin de les rendre compétitifs par rapport à la concurrence étrangère,
– de lutter contre les détournements de fonds et les producteurs fictifs
– de désenclaver les bassins de production,
– de réduire le prix des intrants,
– d’imposer la présence du riz camerounais et des produits à base de farines locales dans les cérémonies organisées par les administrations publiques,
– de créer des marchés captifs pour encourager la production nationale, Les hôpitaux publics, les prisons, les restaurants situés, dans des enceintes publiques, peuvent être transformés en grands centres de consommation et de vulgarisation permanente des produits locaux.
Les autres denrées tels le maïs, le manioc, la banane plantain, le haricot…sont entravées par l’enclavement des bassins de production, l’exode rural, la cherté des engrais, le changement climatique, les difficultés d’accès à la terre, le détournement des subventions par des faux agriculteurs… Il convient de lever ces obstacles. Fait psychologique humiliant, le Cameroun importe l’huile de palme du Gabon. Qui l’eût cru?
Poisson
Malgré son immense potentiel, le Cameroun est importateur net de poissons. 130 milliards FCFA dépensés en 2024, selon l’INS. Le pays s’appauvrit tout en créant richesse et emplois dans les autres pays. Il convient de :
– de soutenir les producteurs locaux,
– de rendre accessible les aliments pour poisson,
– d’imposer un quota d’espèces locales (silure, tilapia…) dans les poissonneries,
– de vulgariser l’élevage de poisson à domicile, dans les bacs,
– de créer un marché captif pour espèces aquatiques locales, d’imposer ces espèces dans les cérémonies organisées par les administrations publiques.
Aviculture
Ce secteur structurant a du plomb dans l’aile. La production nationale est en chute libre. De 70 millions à 30 millions de poulets de chair par an. Néanmoins, la filière avicole demeure un vivier d’emplois : 311.000. Loin devant la Cameroon development corporation (CDC) avec 220 000 emplois, du temps de sa splendeur, et juste derrière la fonction publique, avec 411 749 emplois au 31 décembre 2024, d’après le MINFOPRA. Il convient de :
– de soutenir les éleveurs,
– de réduire le coût des intrants, notamment le maïs dont le prix élevé obère la filière,
– de réhabiliter le Complexe avicole de Mvog-betsi,
– de multiplier les unités de découpe de poulet de chair afin d’offrir une alternative crédible à la vente sur pied, source de grosses pertes pour les éleveurs,
– D’accentuer la lutte contre les importations clandestines de poulets de chair.
En raison d’une démographie galopante, les défis de demain seront, entre autres, alimentaires. Par conséquent, l’AJAD invite les électeurs à être particulièrement regardants sur la façon dont les candidats abordent cette question. Il en va de leur avenir !
Thierry Djoussi
Président de l’Association des journalistes camerounais pour l’agriculture et le développement (AJAD)
+237674377796


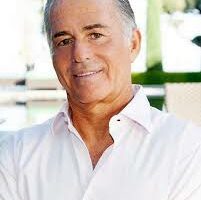






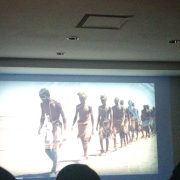


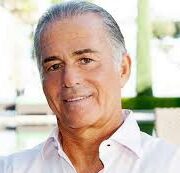




Comments